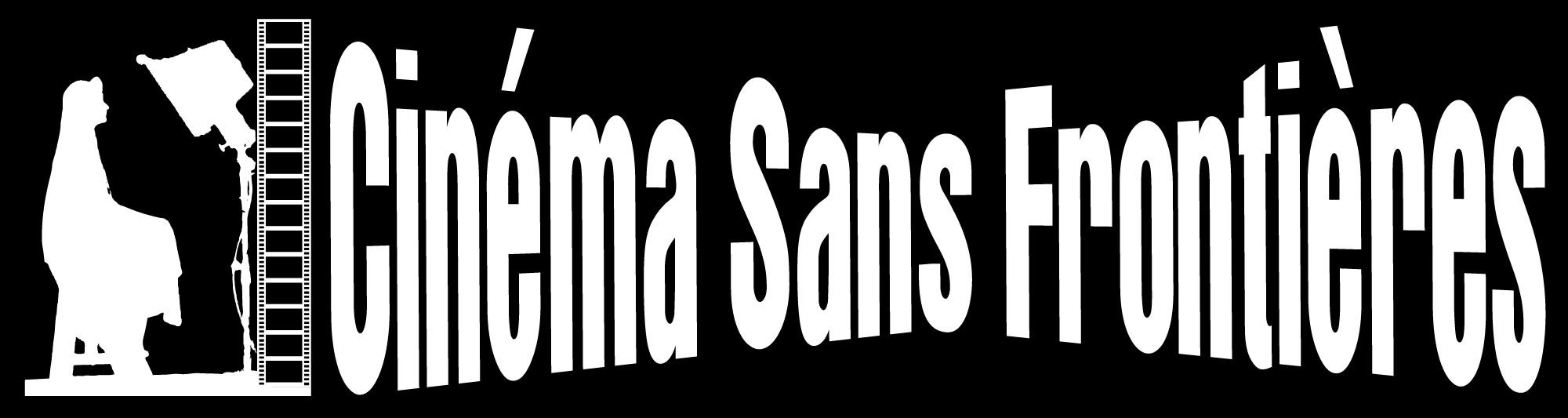Vendredi 21 Février 2014 à 20h30 – 12ième Festival
Cinéma Mercury – 16 place Garibaldi – Nice
Film de Cheick Omar Sissoko – Mali – 1999 – 1h42 – vostf
Trois siècles après le déluge, le clan de l’éleveur Jacob et de ses fils se déchire avec le clan des cultivateurs sédentaires conduit par Hamor. Quant à Esaü, chef du peuple des chasseurs, il prépare sa vengeance. Frère de Jacob, Esau lui voue une haine mortelle depuis que celui-ci a subtilisé son droit d’aînesse. Reclus dans son campement, Jacob pleure la perte de son fils Joseph, qu’il croit mort.
Notre article
par Josiane Scoleri
La Genèse est un film qui nous transporte, qui nous embarque d’un souffle pour un voyage dans le temps ou plutôt dans les temps des débuts du temps. Au moment où les hommes n’ont pas encore tous oublié qu’ils ont d’abord été nomades. Certains d’ailleurs le sont encore et se consacrent toujours à la chasse, d’autres sont devenus éleveurs et nomadisent avec leurs troupeaux d’un pâturage à l’autre. D’autres encore se sont totalement sédentarisés. Ils sont devenus cultivateurs et ont tendance à considérer qu’ils ont atteint de ce fait un degré supérieur de civilisation…
La transposition de l’histoire de Jacob et Esaü en Afrique s’impose dès le départ avec une évidence totale. Elle sonne vrai et prend d’emblée un relief puissant. Nous voyons le récit s’inscrire intensément dans les paysages et le corps des acteurs. En un mot, nous y sommes. Nous y sommes comme nous ne l’avons jamais été à la lecture de la Bible ou devant aucune autre adaptation qui se voudrait plus proche du texte. Ici d’ailleurs, nous oublions qu’il y ait jamais eu un texte. Nous sommes plongés dans le temps de la parole. Sur ce plan-là aussi, l’Afrique fait pleinement sens.
La force du film de Sissoko tient en grande partie à cette évidence vibrante. Nous sommes immergés dans ces histoires de vols de troupeaux et d’enlèvement de femmes dont nous savons bien qu’elles ont rythmé la vie de l’humanité pendant des millénaires. Mais surtout, nous voyons se déployer sous nos yeux les affects les plus terribles, et d’abord la haine première, la haine entre frères. Elle habite l’écran, elle habite les personnages avec une force incantatoire dès le premier instant (Cf l’invocation d’Esaü face à l’immensité du paysage la première fois qu’il apparaît à l’écran).
Tous les acteurs sont simplement magistraux ; que ce soit Sotigui Kouyate qui campe un Jacob digne, blessé et solitaire, ou Moussa Keita qui fait de Hamsor un chef de clan puissant et pourtant défait, ou encore Salif Keita qui réussit à donner à Esaü une grande humanité au coeur même de sa soif de vengeance. Tous se sont approprié le souffle du mythe.
Quand le cinéma recrée le mythe et lui donne vie sous nos yeux.
Le récit mythique, le récit fondateur est très certainement la première forme d’expression artistique. La Genèse nous donne justement à voir cette dimension primordiale. Depuis toujours les hommes ont éprouvé le besoin de se raconter pour se rassurer et essayer d’y voir plus clair dans la nuit de l’existence, pour se souvenir de leurs origines et/ou se les inventer…C’est sans doute la raison pour laquelle les récits fondateurs nous parlent et nous émeuvent quel que soit le coin du monde dont ils viennent. Ici bien sûr, l’histoire est intimement liée aux trois monothéismes et l’écho chez nous y est immédiat et amplifié d’autant.
La Genèse nous parle de la nécessité d’appartenance et du rôle de la croyance, de la primauté des liens de sang et de l’exercice du pouvoir, de la force de l’enracinement et aussi de celle de l’exil. Ce sont les thèmes éternels des hommes dans leur difficulté a vivre ensemble, où il est question de parole donnée et trahie, d’amour, de guerre, de ruse, de colère, et quelques fois, comme une oasis improbable au milieu du désert, de sagesse. C’est l’Iliade et l’Odyssée, le Mahabarata, le Ramayâna, les sagas islandaises, le livre du Popol Vu et tant d’autres qui n’ont peut-être pas de titre connu.
La mise en scène de Sissoko s’appuie sur le réel qui se trouve au coeur du mythe. Mais, dans le même temps, elle tire « tout naturellement » parti de la pratique profondément africaine et toujours vivante aujourd’hui de la palabre. La palabre implique une nécessaire théâtralisation de la parole et Sissoko se saisit de cette possibilité avec les outils du cinéma : les gros plans sur les visages, les champs/contre-champs les plus simples prennent une intensité surprenante et le hors champ est habité par ce divin qui occupe tant les hommes. Le rythme est ample, parfaitement en phase avec le déroulé de l’histoire.
Lorsque, par moment, Sissoko a recours au flash-back pour nous éclairer sur la généalogie (nous sommes malgré tout dans l’Ancien Testament où les histoires de filiation sont essentielles), nous sommes presque déçus de le voir quitter la mise en scène de la parole pour celle plus classique de l’image. De la parole incarnée, nous passons à la narration, mais les images gardent à tout moment leur beauté simple et majestueuse. Elles s’inscrivent elles aussi dans la nécessité absolue de la transmission. Jacob raconte le passé à un tout jeune garçon, car le plus important c’est que l’histoire ne soit pas perdue. Ce faisant, Sissoko va à l’essentiel, il se concentre sur les questions vitales : Lorsque le frère est trahi par le frère, lorsque le père est trahi par ses fils, comment sortir de l’impasse? Comment trouver une issue? La réconciliation est-elle possible ? Si nous sommes revenus à l’état de délabrement de la société d’avant le déluge, faudra-t-il un autre déluge ? La scène sensée figurer le combat de Jacob avec l’Ange est de toute beauté. Car, dans la nuit profonde, seuls les jeunes enfants qui courent tels des lutins ou des feux follets dans la plaine ont encore la parole. De toute évidence, ils ne connaissent pas la peur, ils peuvent côtoyer (figurer ?) le divin. Il faut encore dire à quel point Sissoko tire parti de tous les jeux de lumière, du grand soleil qui écrase le désert et blanchit presque les couleurs pourtant éclatantes à la pénombre des cases qui magnifie les ombres. Plusieurs scènes sont tournées de nuit, et nous ne sommes pas dans la « nuit américaine », nous sommes dans le Noir.
Enfin, comment parler du film sans évoquer les costumes qui suffisent eux aussi à nous parler d’un autre temps, les couvre-chefs somptueux qui disent le pouvoir, sans qu’à aucun moment, on verse dans l’anecdotique. La Genèse compose ainsi une symphonie visuelle dont on se souvient
Sur le web
 La Genèse, dixième film de Cheick Oumar Sissoko scénarisé par l’écrivain et philosophe français Jean-Louis Sagot-Duvauroux raconte les chapitres 21 à 35 du premier livre de l’Ancien Testament, soit l’histoire d’Isaac, fils d’Abraham et de Jacob (qui deviendra par la suite Israël), jusqu’au départ de ce dernier du pays de Canaan vers l’Égypte. Où la tradition judéo-chrétienne veut que cette histoire se soit déroulée pas bien loin du pays d’Ur (la Babylonie), Sissoko déplace le récit des origines au Mali, en Afrique, berceau de l’humanité. L’idée de Sissoko, si elle est théologique en surface, ne l’est que pour les besoins de son public, malien ou d’ailleurs, qui verra dans le récit un point d’origine à toute une écriture de la mythologie de l’homme, qu’elle soit chrétienne ou islamique.
La Genèse, dixième film de Cheick Oumar Sissoko scénarisé par l’écrivain et philosophe français Jean-Louis Sagot-Duvauroux raconte les chapitres 21 à 35 du premier livre de l’Ancien Testament, soit l’histoire d’Isaac, fils d’Abraham et de Jacob (qui deviendra par la suite Israël), jusqu’au départ de ce dernier du pays de Canaan vers l’Égypte. Où la tradition judéo-chrétienne veut que cette histoire se soit déroulée pas bien loin du pays d’Ur (la Babylonie), Sissoko déplace le récit des origines au Mali, en Afrique, berceau de l’humanité. L’idée de Sissoko, si elle est théologique en surface, ne l’est que pour les besoins de son public, malien ou d’ailleurs, qui verra dans le récit un point d’origine à toute une écriture de la mythologie de l’homme, qu’elle soit chrétienne ou islamique.
Dans les faits, La Genèse relate plus précisément un fratricide : celui de l’Afrique, du Rwanda, de cette époque où la dictature malienne infligeait à son peuple les pires sévices jusqu’à ce qu’un mouvement de libération, dont Sissoko faisait partie en 1991, renverse la vapeur et instaure une nouvelle démocratie. La mise en abyme, réussie, l’est car elle s’applique systématiquement à l’histoire de son pays, mise en parallèle aux anciens écrits qui, par leur correspondance, augmentent la qualité d’universalité du film de son brillant conteur. En plein désert de Sahel, près du village de Hambori, on regarde vers le ciel en s’exclamant que Dieu créa l’homme, mais pas l’eau; rappelons que nous sommes quelques générations après le grand déluge qui épargnât Noé en vidant, apparemment, l’Afrique. Dieu créa la femme, mais aussi des frères, ces autres hommes susceptibles, tout comme nous, de désirer notre possession – qu’elle soit terre ou chair – et de ultimement nous tuer pour nous la prendre des mains. Dieu ayant créé à la fois l’objet et le désir, c’est dans cette optique que le monde inaugural du cinéaste est  dysfonctionnel, voué au carnage qui, hors de tous doutes, constitue l’une des scènes-chocs d’une oeuvre plutôt joviale et enivrante. L’Afrique est dans un cercle vicieux de violence dont elle ne semble pas capable de s’extraire. Des frères se tuent entre eux. Du temps d’Abrahama comme du temps du génocide rwandais.
dysfonctionnel, voué au carnage qui, hors de tous doutes, constitue l’une des scènes-chocs d’une oeuvre plutôt joviale et enivrante. L’Afrique est dans un cercle vicieux de violence dont elle ne semble pas capable de s’extraire. Des frères se tuent entre eux. Du temps d’Abrahama comme du temps du génocide rwandais.
Deux frères, chefs de clan, se font la guerre : Jacob et Esaü, fils d’Isaac, tandis qu’un troisième parti, Hamor, chef d’une tribu animiste, viendra complexifier la donne. Ayant piégé son frère dans un épisode qui donnera le fameux « qui va à la chasse, perd sa place », Jacob usurpe à Esaü les droits de l’aîné à succéder à leur père, déjà prophète et porteur de la parole divine. L’homme se place au centre du cadre et Sissoko, amoureux des travellings latéraux tranquilles et précis, va et vient entre des figures aux costumes imposants, aux couleurs et aux accessoires symbolisant leurs castes respectives (de chasseurs, de cueilleurs et de sorciers). Il le scrute tel le monolithe qu’il est, planté là au beau milieu du désert – et quel beau milieu, justement. Loin du fleuve Niger, on ne voit à perte de vue que d’autres monolithes, rocailleux, eux, faisant concurrence à des comédiens chantant leur langue maternelle – le bambara (parlé par un peu plus de dix millions d’êtres humains, surtout au Mali). Or, le territoire  désertique qu’affectionne Sissoko nous amène à repenser le territoire de ces peuplades dont le jeu de théâtre qu’on nous sert aux coins brechtiens – les anachronismes sont fréquents, mais volontaires – nous distancie dans la mesure du possible du pathos. Ce possible, c’est l’idée pour laquelle Sissoko est prêt à sacrifier le réalisme et les détails qui ajouteraient la mention « historique » ou « biblique » à son « conte » bien fier de n’être que « conte ».
désertique qu’affectionne Sissoko nous amène à repenser le territoire de ces peuplades dont le jeu de théâtre qu’on nous sert aux coins brechtiens – les anachronismes sont fréquents, mais volontaires – nous distancie dans la mesure du possible du pathos. Ce possible, c’est l’idée pour laquelle Sissoko est prêt à sacrifier le réalisme et les détails qui ajouteraient la mention « historique » ou « biblique » à son « conte » bien fier de n’être que « conte ».
D’Abraham à Isaac, voilà comment on définit l’avant du déluge, cette époque où, selon les protagonistes du film, les problèmes se réglaient facilement. Ensuite, le déluge qui balaie tout, ne laisse que du désert sur ce qui devait contenir autrefois l’Éden luxuriant en feuillages. À cette table rase du Tout-Puissant s’ensuit la guerre des clans, menée par Jacob et Ésaü, stoppée et redémarrée suite à un quiproquo (quoique l’homme à ce don de mettre les massacres sur le dos du hasard). Le fils de Jacob prendra la fille de Hamor comme épouse et, pour s’allier à la famille juive, ce dernier devra faire circoncire sa tribu; le premier sang versé est celui de la conversion à la religion du pouvoir dominant. Malgré le sacrifice, les hommes de Jacob ne seront satisfaits et profiteront de la garde baissée de leurs nouveaux alliés de sang pour les massacrer. À ce cycle de violence sans fin s’appose l’Histoire de l’Afrique colonisée, celle du Mali qui, dès 1883, voit la France coloniser son Empire, le priver de son identité pour la lui redonner en 1960.
 Une fois le « déluge » passé, l’évolution de la nation, nouveau germe d’une terre aride, parce qu’inondée par le sang, ne peut que se développer dans la confusion, l’incommunicabilité des nombreuses tribus et le conflit civil; La Genèse, récit premier, établissait déjà cette idée que l’apprentissage (ou la naissance) dans la violence, ne pouvait qu’aboutir à créer un être envieux.
Une fois le « déluge » passé, l’évolution de la nation, nouveau germe d’une terre aride, parce qu’inondée par le sang, ne peut que se développer dans la confusion, l’incommunicabilité des nombreuses tribus et le conflit civil; La Genèse, récit premier, établissait déjà cette idée que l’apprentissage (ou la naissance) dans la violence, ne pouvait qu’aboutir à créer un être envieux.
L’arbre généalogique, chez Sissoko, est donc la source des anecdotes peuplant ses films. Contrairement à Guimba, un tyran, une époque qui en faisait son point de départ pour sa tragédie, La Genèse apparaît comme une oeuvre plus achevée en ce sens qu’elle transcende le pathos de la jalousie et du désir – elle les aborde en allant au-delà – et se niche dans une réflexion représentative de tout un idéal africain cherchant à bâtir un nouvel espace à partir de fondations inégales, trop ondulées par les cicatrices boursouflées qui nervurent son continent. Lors d’une séquence où les diplomates se rencontrent, des soldats viennent se moquer d’eux et symbolisent d’abord que cette inadéquation est une erreur de l’homme, ensuite que le rôle du soldat (il est peut-être chasseur, mais nous ne le voyons jamais pourchasser le gibier) est aussi à repenser. Comme le déluge qui n’est jamais montré, comme ce jeu sur l’idée de la vendetta où l’on ne pardonnera jamais à la famille adverse, Sissoko semble s’intéresser à ce présent plutôt qu’au déluge et, de ce fait, responsabilise l’Afrique contemporaine à son propre sort en désamorçant la haine issue d’une pensée post-colonialiste aux diverses interprétations.
« Il rejette la vocation violente que son cinéma pourrait prendre, démontre, par sa dialectique toute puissante visant à illustrer et à comparer en fonctionnalisant la géopolitique complexe de l’Afrique subsaharienne tout en traitant la question avec assez de nuances pour ne pas tomber dans le manichéisme dénoncé tout du long. Prudent, il ne peut qu’aboutir à une autre question, celle le plaquant contre le mur, lui demandant à quand la fin de la misère et quand, comme le Jacob pardonné, puis illuminé par un ange à la fin du livre premier, le peuple s’unira-t-il sous la bannière d’un nouveau prophète. Virons les cols romains et les Saints de l’histoire, stipulons que la question du cinéma africain devrait et sera approfondie dans les années qui viennent et ce n’est peut-être que sous ces auspices que l’on saisira l’originalité de ce troubadour aux atours bien cachés de pamphlétaire. Celui qui chante comme le griot et filme comme le plus habile des cinéastes l’espoir qu’un jour on regardera son cinéma comme le nôtre, qu’on lira sa Genèse comme la nôtre. » (Mathieu Li-Goyette pour Panorama-cinéma)
Présentation du film et animation du débat avec le public : Josiane Scoleri.
Merci de continuer à arriver suffisamment à l’avance pour être dans votre fauteuil à 20h30 précises.
N’oubliez pas la règle d’or de CSF aux débats :
La parole est à vous !
Entrée : 7,50 € (non adhérents), 5 € (adhérents CSF et toute personne bénéficiant d’une réduction au Mercury).
Adhésion : 20 €. Donne droit au tarif réduit à toutes les manifestations de CSF, ainsi qu’à toutes les séances du Mercury (hors CSF) et à l’accès (gratuit) au CinémAtelier.
Toutes les informations sur le fonctionnement de votre ciné-club ici